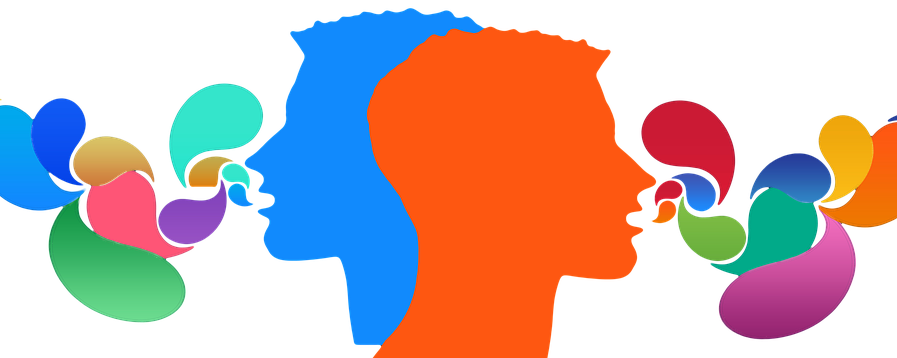La création de ce réseau marque la volonté pour le ministère d’évoluer vers un système d’information de l’État basé sur les technologies les plus avancées auquel ont accès les agents partout dans le monde.

Lorsque vous êtes arrivé au ministère, en 2011, vous avez mis fin au télégramme diplomatique pour faire basculer l’ensemble de la correspondance diplomatique dans un réseau dédié. Ce changement s’est-il opéré facilement ?
Ce changement était surtout souhaité, pour plusieurs raisons. Le cloisonnement excessif de la correspondance diplomatique était un facteur de rigidité et de dysfonctionnements, notamment en interministériel. Le caractère de plus en plus global et immédiat des crises nécessitait un nouvel outil de traitement de l’information, qui prenne en compte l’impératif du partage en sus de l’exigence du droit de connaître. Le besoin exprimé par les agents de méthodes de travail moins verticales et plus collaboratives invitait également à revoir la circulation de la correspondance. L’explosion de la volumétrie des courriels posait enfin des problèmes de conservation et de sécurité de ces flux non contrôlés et, d’une manière générale, de gestion de cette information non formalisée.
Aucun changement n’est facile : c’est pourquoi nous avons développé ce nouvel outil avec les agents dès l’engagement du projet, de telle manière que le produit final soit adapté à leurs attentes et à leurs besoins. Nous avons considéré que l’outil ne change pas les méthodes de travail : c’est, au contraire, parce que les méthodes de travail ont évolué, parce que le management public a évolué, parce que la modernisation de l’action publique a placé la transition numérique au cœur de ses projets, qu’il était devenu possible et nécessaire de fournir un nouvel outil de correspondance.
Quel est le mode de fonctionnement du réseau « Diplomatie » que vous avez mis en place ?
« Diplomatie » intègre, dans une solution sécurisée, un réseau social, une gestion électronique de documents, un moteur de recherche, une signature électronique et un archivage numérique.
L’innovation a consisté à constituer des groupes fonctionnels d’État, représentant les administrations, aux côtés de communautés d’intérêt thématiques. Les agents publics, qui relèvent tous d’un groupe fonctionnel, peuvent adhérer aux communautés d’intérêt pour lesquelles ils disposent d’une expertise. Ainsi sont-ils en mesure d’accéder non seulement à l’information adressée à leur groupe, mais aussi aux flux documentaires versés dans les communautés d’intérêt auxquels ils sont abonnés. Ce mécanisme assure que chaque agent, pris individuellement, se constitue le patrimoine documentaire le plus pertinent pour ses besoins ; en contrepartie, l’agent est en mesure de valoriser mieux qu’auparavant son expertise personnelle au bénéfice de l’intérêt général.
Autre innovation, le portail « Diplomatie » est accessible sur les postes de travail habituels de tout agent public, fixes ou mobiles, dès lors que son administration a souscrit aux règles de sécurité correspondant au niveau de protection de la correspondance diplomatique. Ce décloisonnement interministériel garantit la fluidité et le partage au sein du gouvernement et contribue à l’émergence d’un système d’information de l’État reposant sur les technologies les plus avancées. Ce réseau fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, à l’échelle mondiale ; il est désormais possi- ble de travailler en mode collaboratif où que l’on se trouve, entre les postes et les administrations centrales, sans distinction de service de rattachement.
Outre ce réseau, interadministrations, se sont mis en place un certain nombre d’outils de communication beaucoup plus conviviaux, notamment les « Chroniques de la diplomatie », qui racontent le quotidien de nos diplomates. Est-ce un moyen de se rapprocher de la société civile ?
Le blog Carnets diplomatiques vise à raconter le quotidien des diplomates, à lever le voile sur nos activités pour mettre à mal certains clichés qui ont encore la vie dure. Il fait partie d’un ensemble de contenus Web que nous avons mis en place, afin d’adopter une ligne éditoriale moins institutionnelle, et ainsi de faire connaître la multitude d’actions menées par notre ministère. Par exemple, nous avons créé une console Twitter, qui permet de suivre l’activité du réseau diplomatique dans son ensemble sur Twitter. Nous avons aussi développé une application « Vu(e) de ma fenêtre » qui permet d’avoir un aperçu de la réalité des agents en poste dans le monde. Le tumblr Chroniques diplomatiques va également dans ce sens. Nous nous adaptons au ton spécifique de chaque plateforme sur le Web social, et d’engager une conversation tournée en effet vers la société civile. De plus, le renforcement de la dimension de service public grâce à notre large présence sur le Web social est un axe important de notre stratégie. Nous avons, par exemple, créé un compte Twitter pour les conseils aux voyageurs, ces fiches qui délivrent en temps réel des recommandations de sécurité aux Français se rendant à l’étranger. En résumé, on peut dire que notre souci est effectivement de nous rapprocher de la société civile, en lui montrant que les diplomates et tous les agents qui travaillent au ministère des Affaires étrangères sont des Français comme les autres, avec leurs qualités et leurs défauts et que toutes ces personnes contribuent, de manière très concrète, à l’intérêt général de nos compatriotes.
Internet est-il le moyen privilégié de faire de la diplomatie publique ?
C’est le pendant de ce qui est évoqué plus haut. Nous abordons nos comptes sur les réseaux sociaux comme de véritables outils d’influence. Engager et s’insérer dans les conversations, c’est aussi trouver un moyen plus direct pour y diffuser nos messages, auprès des sociétés civiles tant françaises qu’étrangères (le ministère est présent en plusieurs langues – y compris l’arabe – sur les réseaux sociaux) et de mieux comprendre leurs attentes vis-à-vis de notre diplomatie. De plus, nous travaillons en synergie avec tout notre réseau diplomatique, ce qui amplifie considérablement la portée de nos messages. En nous offrant l’occasion d’entrer en contact avec un public qui, traditionnellement, ne se rend pas sur les sites institutionnels, les réseaux sociaux peuvent lui faire savoir que notre action le concerne également.
Est-ce aussi un moyen efficace pour lutter contre le « French Bashing » ?
Notre présence de long terme sur le Web nous a permis d’effectuer une veille sur les émetteurs de cette série de propos dirigés contre la France et d’y répondre à chaque fois que nécessaire. L’attitude de notre poste à Londres qui a réagi très rapidement et méthodiquement, en particulier sur Twitter, aux critiques dont notre pays faisait l’objet, est à cet égard remarquable. De manière générale, nous n’utilisons pas nos contacts directs avec la société civile pour engager la polémique, simplement pour corriger les faits lorsqu’ils sont inexacts et fournir les informations les plus justes possibles. Cela permet bien souvent de relativiser la portée de certaines remarques, y compris lorsqu’elles sont émises depuis la France.
L’affaire Wikileaks, dont vous vous êtes occupé, a montré la nécessité, pour la diplomatie, d’investir le terrain de la communication Web, mais aussi de protéger les informations dites sensibles. Comment est gérée cette ambivalence ?
Il n’y a pas d’ambivalence ni de confusion entre la diplomatie publique et le secret de la correspondance, car ils ne remplissent pas le même objet. Ce que Wikileaks a mis en lumière est l’exigence croissante que l’opinion publique manifeste pour la transparence de l’action publique : cela a conduit les diplomaties dans la plupart des pays à renforcer de manière significative leur diplomatie publique, en expliquant les métiers des diplomates, et en valorisant leurs actions de terrain. Parallèlement, les gouvernements ont pris conscience qu’à l’ère du numérique et des média sociaux, la question du secret devait être repensée, non pas en fragilisant des pourparlers qui doivent demeurer confidentiels pour aboutir, non pas non plus en mettant en danger des diplomates qui exercent leur mission dans des conditions souvent difficiles, mais en évitant de couvrir par le secret des réflexions ou des analyses qui ne présentent pas de caractère sensible et qui sont utiles à l’information des acteurs économiques ou culturels qui travaillent à l’international. C’est en partageant plus largement l’expertise de notre réseau diplomatique avec la société civile que l’État parviendra à mieux protéger les secrets dont il a la responsabilité. La diplomatie d’influence est justement cette capacité à occuper le terrain de la parole publique de manière aussi participative que possible, tout en laissant aux diplomates la marge d’expression protégée dont ils ont besoin pour défendre les intérêts de la nation dans un monde complexe et parfois hostile.
Nos ambassadeurs ne font pas tout à fait partie de la génération geek. Ont-ils compris la nécessité d’utiliser les réseaux sociaux ? S’y sont-ils adaptés rapidement ?
Les réseaux sociaux font désormais partie intégrante de l’exercice de la diplomatie publique. Tous les diplomates français bénéficient, avant leur départ en poste, d’une formation à l’utilisation des réseaux sociaux. Des sessions sont également organisées pour ceux qui sont déjà en poste à l’étranger, ainsi que pour les agents à mi-carrière en fonctions à Paris. Il s’agit finalement d’une extension naturelle du champ d’action du diplomate d’aujourd’hui, comme l’ont très bien compris les agents, notamment les ambassadeurs, souvent déjà présents à titre personnel sur ces réseaux.